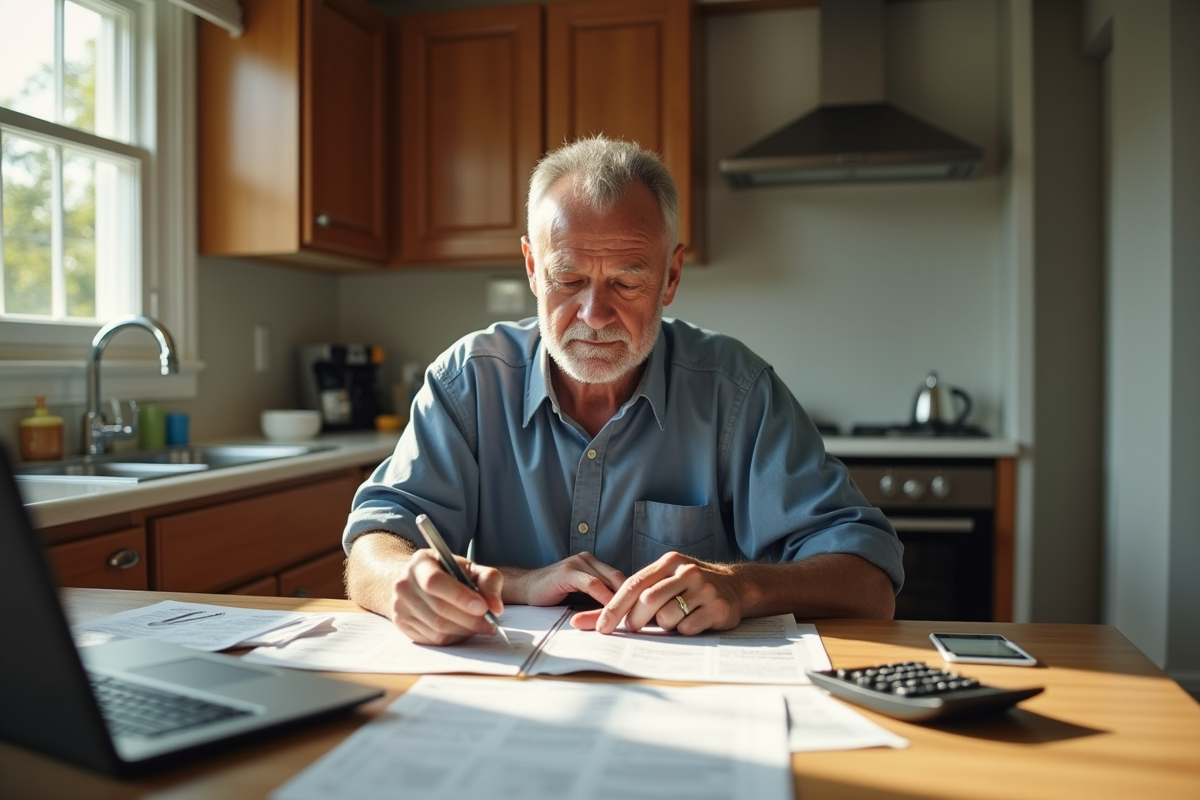Un citoyen américain vivant à l’étranger reste soumis à l’impôt fédéral sur le revenu, même s’il n’a aucun revenu d’origine américaine. Le Delaware, État de moins d’un million d’habitants, abrite plus d’un million d’entreprises à cause de règles fiscales avantageuses. Certaines taxes, comme la TVA, n’existent pas aux États-Unis, tandis que d’autres, comme la taxe sur la propriété, sont prélevées localement et varient fortement d’un État à l’autre.
Ce système juxtapose impôt fédéral, impôts d’État et parfois locaux, créant une mosaïque complexe pour les particuliers, les entreprises américaines et les étrangers installés sur le territoire.
Panorama des impôts aux États-Unis : ce qu’il faut savoir
Oubliez la simplicité : le système fiscal américain fonctionne comme un mille-feuille où chaque couche apporte son lot de règles, de taux et d’exception. Chaque citoyen ou résident doit s’acquitter d’un impôt fédéral sur le revenu. Les taux marginaux, eux, s’étirent de 10 % à 37 % selon les revenus. Mais l’histoire ne s’arrête pas là : à la facture fédérale s’ajoutent les impôts d’État. Certains États, comme le Texas ou la Floride, n’imposent rien sur le revenu. D’autres, à l’image de la Californie ou New York, appliquent des barèmes progressifs qui s’accumulent avec la fiscalité fédérale.
Voici les principaux impôts qui structurent le paysage américain :
- Impôt fédéral sur le revenu : il s’applique sur l’ensemble des revenus mondiaux des citoyens et résidents fiscaux américains. Les déductions et crédits d’impôt permettent d’alléger la note, mais la déclaration reste un exercice pointu.
- Impôts d’État (state income tax) : chaque État décide de ses propres règles. Le taux varie de 0 % à plus de 13 %. Certains États font le choix du zéro, d’autres préfèrent des barèmes progressifs ou forfaitaires, ce qui peut transformer la charge fiscale d’un simple changement d’adresse.
- Taxe sur la vente (sales tax) : elle s’applique à la plupart des achats. Son taux va généralement de 4 % à 10 %, mais chaque État, et parfois chaque ville, décide de ses propres chiffres. Résultat : acheter le même produit à New York ou à Portland ne coûte pas la même chose.
Le pourcentage du revenu absorbé par les impôts dépend donc d’une multitude de facteurs. Superposition des prélèvements, disparités des taux d’imposition, influence directe de la résidence : le paysage fiscal américain ne tient pas en une seule équation. L’absence de TVA nationale, couplée à la profusion de taxes locales, rend la comparaison internationale encore plus délicate.
Ce système nourrit la concurrence entre les États. Certains ménages ou entreprises n’hésitent pas à déménager leur siège ou leur domicile pour alléger leur imposition. Cette mosaïque façonne une stratégie fiscale à l’américaine, où chaque choix de résidence devient un calcul.
Pourquoi le système fiscal américain est-il si particulier ?
Ce qui distingue le système fiscal américain, c’est cette coexistence inédite de plusieurs échelons d’imposition. Ici, pas de direction unique : le fisc américain est une nébuleuse où le fédéral, les États et parfois les municipalités imposent chacun leur logique. Chacun possède ses lois fiscales, ses taux, ses exceptions, héritage d’une histoire fédérale jalouse de ses équilibres.
La résidence fiscale n’est pas un simple détail administratif. Elle pèse lourd sur le montant prélevé, la nature des taxes, la mécanique des déclarations. Là où la France centralise, les citoyens américains jonglent entre la rigueur du fédéral et l’inventivité, parfois la sévérité, de leur État d’adoption. Le Wyoming ou le Nevada préfèrent renoncer à l’impôt sur le revenu pour attirer entreprises et particuliers. La Californie, elle, mise sur des taux élevés pour financer ses ambitions.
Autre trait marquant : l’extraterritorialité. Un citoyen américain reste redevable de l’impôt sur ses revenus mondiaux, même s’il vit à l’autre bout du globe. Rares sont les pays à imposer ainsi leurs ressortissants expatriés. Les conventions, notamment avec la France, cherchent à éviter la double taxation, mais la complexité demeure, minée par des formulaires et des justificatifs à n’en plus finir. Ici, la fiscalité ne se contente pas de prélever : elle influence les choix de vie, encourage l’optimisation, impose ses frontières invisibles entre liberté individuelle et solidarité.
L’impôt sur les sociétés aux USA : fonctionnement, taux et obligations
Le corporate income tax, ou impôt sur les sociétés, concerne toutes les entreprises américaines, des géants mondiaux aux PME locales. À l’échelon fédéral, la règle est claire depuis 2017 : le taux est fixé à 21 %, bien en dessous des 35 % qui prévalaient auparavant. Mais ce n’est qu’une partie de l’équation. Les États ajoutent leur propre couche, avec des taux variant généralement entre 0 % et 12 %. Au final, selon la localisation et la structure, le taux moyen d’imposition oscille entre 25 % et 27 %.
Les entreprises doivent composer avec des obligations déclaratives complexes. Déclaration annuelle au fisc fédéral (IRS), puis, souvent, déclaration séparée auprès de l’État : impossible d’y couper. Pour les LLC (Limited Liability Companies), la fiscalité dépend du choix de régime. Imposition directe au niveau des membres ou assimilation à une société classique : tout est affaire de stratégie. Les règles sur les déductions, crédits d’impôt et reports de pertes forment un véritable labyrinthe.
Impossible d’ignorer ces règles si l’on veut accéder au marché, rassurer les investisseurs ou bâtir une entreprise solide. Cette exigence de conformité fiscale pèse sur le quotidien des sociétés américaines, qui jonglent en permanence entre optimisation et transparence. Le système, complexe mais redoutablement efficace, façonne à sa manière le jeu du capitalisme américain.
Expatriés et double imposition : comment les Français sont concernés
La double imposition inquiète ceux qui franchissent l’Atlantique pour travailler ou investir. Un Français installé aux États-Unis doit composer avec deux administrations : l’IRS d’un côté, le fisc français de l’autre. La convention fiscale signée en 1994 entre Paris et Washington tente d’apporter une réponse. Son objectif : éviter qu’un même revenu ne soit frappé deux fois, des deux côtés de l’océan.
Sur le papier, le mécanisme paraît limpide. Mais dans la réalité, la question du lieu de résidence fiscale vient tout compliquer. Les critères divergent : durée de séjour, centre des liens familiaux, cœur de l’activité professionnelle. Un salarié recruté localement à New York relève du système fiscal américain. Un détaché, parfois, reste résident fiscal français. Pour les citoyens américains, les revenus mondiaux demeurent imposables aux États-Unis, quel que soit le pays de résidence.
Voici comment se répartit l’imposition sur les principaux types de revenus :
- Les salaires perçus aux États-Unis subissent généralement l’impôt sur place.
- Les revenus fonciers ou dividendes de source française restent imposés en France, avec un crédit d’impôt pour corriger l’éventuelle double taxation.
Les expatriés doivent composer avec de nombreuses contraintes : déclarations multiples, formulaires particuliers, risques de rectification en cas d’oubli. La lutte contre l’évasion fiscale s’intensifie, notamment grâce au partage d’informations entre administrations. Aujourd’hui, les banques américaines transmettent systématiquement les données à Bercy : le secret bancaire a vécu.
Naviguer dans la fiscalité américaine, c’est accepter de marcher sur un fil, où chaque faux pas peut coûter cher. Mais c’est aussi constater que, des deux côtés de l’Atlantique, l’impôt façonne bien plus que le portefeuille : il redessine les trajectoires de vie, les ambitions et, parfois, le sentiment d’appartenance.