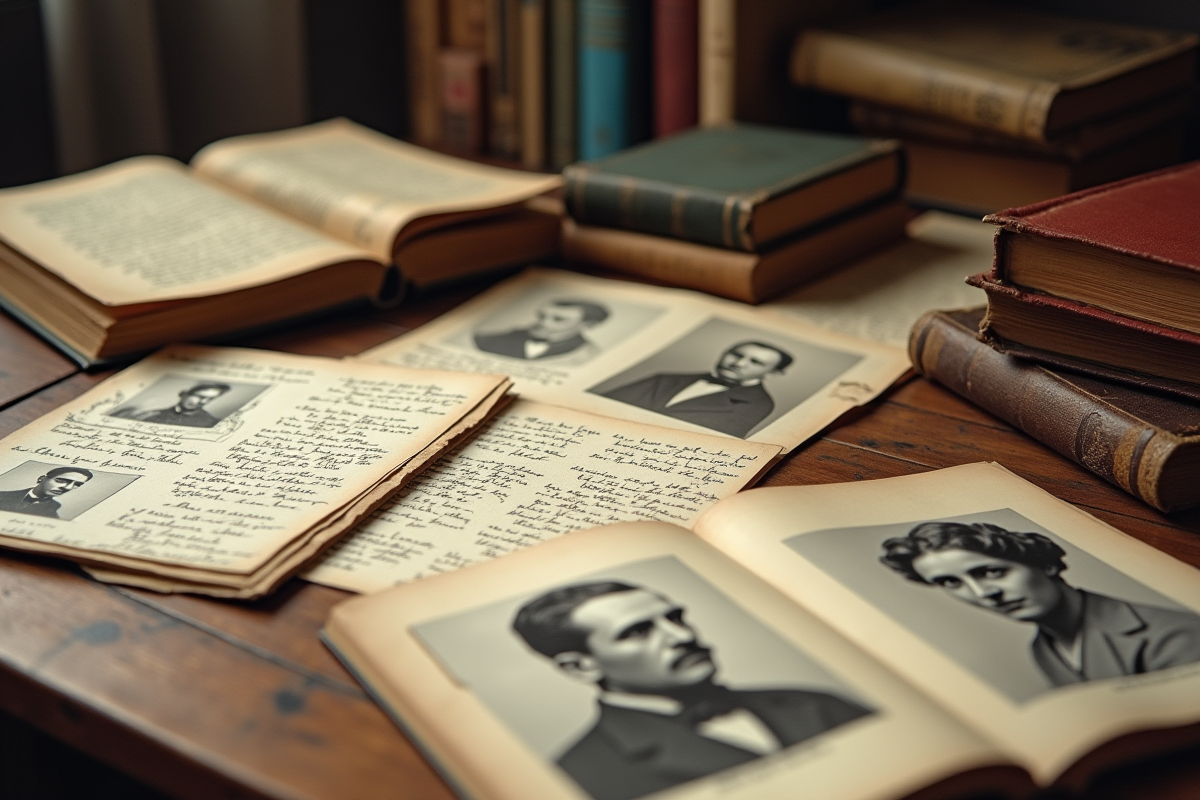Les modèles classiques du développement de l’enfant, largement dominés par les conceptions de Piaget, ont longtemps occulté l’apport singulier d’Henri Wallon. Pourtant, ses travaux ont introduit une dynamique inédite en insistant sur l’interaction constante entre l’individu et son environnement social. L’intégration du mouvement, de l’affectivité et des facteurs sociaux dans l’étude du développement psychologique bouleverse la hiérarchie des approches du XXe siècle. Wallon impose une perspective globale qui continue d’influencer la psychologie de l’enfant, l’éducation et la compréhension des troubles du développement.
Comprendre l’origine de la théorie d’Henri Wallon : un contexte scientifique et social en mutation
Au tournant du XXe siècle, la psychologie française connaît une agitation féconde. L’intellect trône, mais peine à saisir la complexité du développement de l’enfant. C’est dans cet espace en tension que Henri Wallon s’impose, bouleversant les idées reçues. Médecin, philosophe, psychologue, il forge ses convictions au contact direct d’enfants en difficulté, bien loin des bancs universitaires et des certitudes toutes faites. Les transformations sociales, les conflits, les changements dans l’éducation et la montée en puissance des sciences humaines façonnent son regard. Wallon ne se contente pas d’énoncer des principes : il observe, il analyse, il interroge sans relâche la frontière entre l’individu et la société.
Enseignant au Collège de France, il privilégie l’expérience concrète à la théorie désincarnée. Hôpitaux, écoles, familles : Wallon se confronte à la réalité, là où le développement psychologique se construit au quotidien. Il élabore sa réflexion à la croisée de la psychologie développementale et de la clinique, dans une période où l’image de l’enfant se transforme en profondeur. Dès lors, la dimension sociale du développement s’impose : le contexte, la culture, les relations façonnent la construction psychique de manière déterminante.
Wallon s’oppose résolument aux théories strictement biologiques ou cognitives. À ses yeux, la vie mentale de l’enfant prend forme dans le va-et-vient constant avec son environnement social. Son parcours s’entremêle avec les débats pédagogiques, les réformes majeures, le marxisme, et la réflexion sur la place du collectif dans l’éducation. Le développement de l’enfant n’est jamais un simple enchaînement de phases : il se déploie dans le mouvement, la confrontation, les ruptures entre l’individu et le monde qui l’entoure.
Quels sont les concepts clés qui distinguent la pensée de Wallon dans la psychologie du développement ?
Avec Henri Wallon, la manière d’aborder le développement de l’enfant bascule : il met au centre la dialectique des processus psychiques. Plus question de juxtaposer les éléments : tout se joue dans la tension entre affectivité, motricité et cognition. Le développement ne suit aucune ligne tranquille : il avance par crises, conflits, passages parfois chaotiques. Sa théorie dialectique du développement renverse la vision d’une croissance sans à-coups : l’enfant progresse par bonds, par réorganisations, souvent inattendues.
Ce qui frappe dans cette perspective, c’est l’importance du développement socio-émotionnel. Wallon démontre que la personnalité de l’enfant émerge d’abord dans les échanges, les émotions, la communication corporelle, bien avant que la raison abstraite ne prenne le dessus. La motricité structure la relation au monde ; l’affectivité oriente l’apprentissage.
Deux formes de pensée retiennent particulièrement son attention : la pensée par couple et la pensée catégorielle. La première, basée sur des relations horizontales, permet à l’enfant d’associer, de comparer, d’opposer sans hiérarchie. Elle prépare la pensée catégorielle, structurée par des relations verticales, où l’enfant commence à organiser le monde en classes abstraites. Ce passage ne se fait pas d’un claquement de doigts : il s’opère dans la tourmente des crises et des transformations majeures.
Wallon met aussi en avant le syncrétisme : l’enfant a tendance à confondre la qualité de ce qu’il perçoit avec la propriété d’un objet. Pour parvenir à classer, il doit apprendre à distinguer, à affiner son regard, à séparer les caractéristiques. Ce cheminement, profondément ancré dans l’expérience concrète, révèle l’originalité de la conception wallonienne du développement psychologique.
Les stades du développement selon Wallon : une approche dynamique de l’enfant
Wallon propose une lecture des étapes de l’enfance qui rompt avec les modèles figés. Sa théorie des stades du développement distingue cinq grandes périodes, chacune marquée par la tension entre affectivité et motricité. Ce parcours n’emprunte jamais la voie directe : il évolue par crises, par ajustements, par mutations.
Pour mieux comprendre la progression de l’enfant selon Wallon, voici les étapes fondamentales qu’il identifie :
- Le stade de l’impulsivité motrice marque la première année : l’enfant explore le monde à travers ses mouvements, chaque geste devient découverte. L’action prédomine, les émotions fusent, tout passe par le corps.
- Le stade émotionnel s’installe ensuite : l’expression passe d’abord par le ressenti brut. Sourires, larmes, cris deviennent autant de moyens de communication. L’intensité affective structure le lien à l’adulte.
- Le stade sensori-moteur et projectif correspond à l’exploration active. L’enfant manipule, expérimente, projette ses intentions sur les objets. L’intelligence sensorielle gagne en précision.
- Le stade du personnalisme surgit vers trois ans : le « moi » s’affirme, l’enfant s’oppose, revendique, forge son identité à travers le conflit et la négociation.
- Le stade catégoriel ouvre l’accès à la pensée conceptuelle : l’enfant classe, organise, catégorise, et commence à structurer ses connaissances de façon plus abstraite.
Chaque étape s’appuie sur la dynamique entre affect et cognition : les crises propulsent l’enfant vers de nouveaux horizons. Wallon invite à percevoir l’enfance comme un laboratoire vivant, où l’émotion et le groupe deviennent les moteurs de l’évolution psychologique.
Pourquoi la théorie de Wallon reste essentielle pour penser l’éducation et l’accompagnement de l’enfant aujourd’hui
La théorie de Wallon irrigue encore aujourd’hui les pratiques éducatives, bien au-delà du monde universitaire. Elle traverse les programmes scolaires français, nourrit la réflexion des enseignants, accompagne les psychologues et les éducateurs dans leur compréhension du développement de l’enfant. Ici, pas de séparation artificielle : affectivité, motricité et cognition s’entremêlent, chaque enfant avance selon son propre rythme.
Face à l’approche de Piaget, centrée sur la logique, Wallon insiste sur le rôle de l’émotion, de la crise et de la confrontation comme portes d’accès à la pensée. Il refuse la vision d’un développement uniforme, prédictible. Dans la réalité, les professionnels le constatent : un enfant progresse, hésite, teste, puis invente parfois des solutions inattendues. Cette attention portée à la dialectique entre singularité et groupe, entre émotion et raisonnement, continue de nourrir la recherche et d’interroger les modèles contemporains de la psychologie.
Les travaux sur la catégorisation et la pensée par couple, poursuivis par Wallon & Ascoli ou Tran Thong, prolongent ce courant. La pensée wallonienne ne se cristallise jamais : elle s’adapte, s’ouvre, inspire l’accompagnement des jeunes enfants. Cette influence dépasse la sphère scientifique : elle transforme les regards, façonne les pratiques, et reste une boussole pour repenser l’éducation et les parcours de vie. Face à la diversité des chemins, l’approche de Wallon rappelle de toujours garder une curiosité vive, prête à accueillir les détours inattendus du développement.